Le Salon du Livre des Balkans, événement unique en France se tenait les 12 et 13 avril derniers dans les locaux de l’INALCO à Paris. Au programme, rencontres, débats, dédicaces et de nombreux éditeurs venus présenter classiques et auteurs contemporains.
Nous nous sommes entretenus avec plusieurs auteurs et éditeurs pour vous faire découvrir quelques ouvrages marquants sur l’histoire et la culture des pays des Balkans mais aussi une actualité qui dépasse les frontières balkaniques.
Un héros slovène

Nous avions rencontré Zdenka Stimac des Editions Slovènes & Cie lors du Salon du Livre de Paris il y a quelques semaines. Elle nous avait présenté sa traduction de Martin Koeurpane du Haut, du slovène Fran Levstik. Nous la retrouvons aujourd’hui aux côtés de l’illustratrice du livre, Sophie Lecomte, qui nous parle plus en détails de ce conte majeur de la littérature slovène.
“C’est l’histoire d’un homme slovène doté d’une force surhumaine, appelé à la cour d’Autriche pour venir la défendre d’un affreux géant qui tue tout le monde. C’est une sorte de pamphlet, puisque c’est finalement le slovène, le paysan slovène, qui va finir par sauver une cour extrêmement fortunée. Il y a plusieurs lectures possibles du texte, car nous pouvons voir cela comme une critique de la cour, ou une revendication du monde paysan”.
Ce livre est la première traduction en français de cet ouvrage de référence en Slovénie, “Martin Krpan z Vrha” dans la langue originale. Martin Krpan est considéré comme un vrai héros national, que tout le monde a étudié à l’école. Il est une référence car c’est l’un des premiers écrits en langue slovène, publié au 19ème siècle lorsque la Slovénie était rattachée à l’Empire d’Autriche.
Zdenka Stimac a voulu créer une médiation en proposant un ouvrage illustré qui puisse s’adresser à différents types de lecteurs. “J’ai illustré le livre sans n’avoir jamais été en Slovénie, c’était une volonté de l’éditrice de pouvoir découvrir le texte de manière totalement neutre”, nous dit Sophie Lecomte. “Ce sont des œuvres en soit”, précise Zdenka Stimac, “des planches originales avec les techniques utilisées par Sophie Lecomte”.
A noter que la Cie Sol Lucet adaptera Martin Koeurpane du Haut dans un spectacle à partir de septembre 2019.
Comment U2 a marqué Sarajevo

Juste derrière, sur le stand des Editions Intervalles, un livre a attiré notre attention, celui de Bill Carter, « Les Ailes de Sarajevo », paru en 2008.
Véritable témoin du conflit, Bill Carter raconte à sa façon la ville de Sarajevo, une ville qui le marquera à vie, comme nous le raconte Armand de Saint Sauveur, son éditeur : « Il y arrive après un deuil, brisé par la vie, on arrive pas dans une zone de guerre par hasard, et va tomber amoureux de cette ville et de ses habitants qui continuent à vivre malgré les bombardements, qui continuent par exemple à faire du rock dans des caves à peine éclairées, et va décider d’aider cette ville à se relever. Il va monter un bluff absolument incroyable, qui est de convaincre le groupe U2 de s’engager pour la Bosnie ».
Malgré les à peine 2h d’électricité par jour, Bill Carter parvient à envoyer un fax en Irlande, et miracle, le groupe lui répond !
« Il se retrouve alors avec l’attention du plus grand groupe de rock du monde qui lui demande de trouver une idée afin d’attirer le regard du monde sur ce qui se passe en Bosnie. Il va monter une série de liaisons satellite entre les différents concerts de la tournée Zooropa et des gens qu’il va interviewer et filmer au quotidien » , poursuit Armand de Saint Sauveur.
Bill Carter réalisera ensuite un documentaire produit par Bono, “Miss Sarajevo”, qui deviendra le titre d’un morceau écrit par Bono et interprété par le groupe avec Luciano Pavarotti.
C’est une histoire vraie, un roman autobiographique d’aventure comme ceux de Conrad, et un portrait amoureux d’une ville par quelqu’un qui y est aujourd’hui considéré comme un héros. Il a d’ailleurs reçu un passeport de citoyen d’honneur en 2009 par le maire de Sarajevo pour services rendus à la ville pendant la guerre. « J’ai eu l’occasion de l’accompagner là bas et j’ai pu rencontrer presque tous les personnages du livre, et c’est un moment assez émouvant de voir apparaître en chair et en os les personnages d’un roman d’aventure 15 ans après les faits », conclut-il.
L’ambassadeur et le siège

Sarajevo est aussi au centre du livre d’Henry Jacolin, témoin privilégié de la situation durant le siège de la ville. Ambassadeur de France à Sarajevo entre 93 et 95, il a vécu le conflit auprès des habitants mais aussi auprès des politiques. Il vient de sortir « L’Ambassadeur et le siège » dans lequel il relate ce qu’il a vécu du conflit et a accepté de répondre à quelques questions pour Hajde :
Que retenez-vous de ces 3 années passées à Sarajevo ?
C’est une guerre que l’on aurait pu éviter, c’est une guerre que l’UE n’a pas réussie à gérer car Maastricht n’avait pas été signé et n’avait pas les outils pour permettre de régler cette guerre. Je retiens aussi la dignité et le courage des habitants de Sarajevo malgré les conditions dans lesquelles ils vivaient, malgré l’isolement intellectuel dans lequel les ont obligé à vivre les serbes qui assiégeaient Sarajevo.
Quel a été votre rôle comme Ambassadeur de France ?
J’ai surtout essayé de sortir les habitants de Sarajevo de cet isolement intellectuel, en ouvrant un centre culturel français, avec l’installation de livres, de cassettes, de livres pour enfants. J’avais spécifiquement demandé ces livres pour enfants, en voyant tous les enfants du quartier qui tournaient sans rien faire, j’étais alors très heureux de les voir venir lire ces livres. J’ai également soutenu les professeurs de français dans les lycées et surtout les professeurs de l’Université. J’ai soutenu ostensiblement les partis politiques transversaux, c’est à dire sociaux démocrates et libéraux, ceux qui ne reposaient pas sur une vision nationaliste de la Bosnie-Herzégovine.
Aviez-vous déjà un lien avec ce pays avant d’y être envoyé ?
Je suis un vieux balkanique, j’ai étudié le serbo-croate aux Langues Orientales (aujourd’hui INALCO). J’ai été en poste à Belgrade, jeune diplomate dans les années 70 du temps de Tito, et me suis donc retrouvé vingt ans après Ambassadeur de France en Bosnie-Herzégovine en raison de mon expérience de l’Ex-Yougoslavie qui m’a permis d’être tout de suite opérationnel.
Racontez-nous vos rencontres avec les dirigeants de l’époque…
J’ai passé mon temps à rencontrer les politiques. Il y avait 24 ministres, j’en ai rencontré 23. Et les Présidents également. Izetbegović (Président de la République de Bosnie-Herzégovine de 1990 à 1996, ndlr) était un vieux sage, le point d’équilibre entre les différentes factions du SDA, c’est à dire nationalistes durs d’un côté, religieux de l’autre, et partisan d’une Bosnie-Herzégovine multi-culturelle et multi-confessionnelle. Silajdžić (Président du Conseil des ministres bosnien de 1993 à 1996, ndlr), j’avais de bons rapports avec lui car c’était un homme pragmatique.
Je n’avais pas rencontré Tito à l’époque (décédé le 4 mai 1980, ndlr), mais j’étais aux cérémonies pour son 80ème anniversaire dans le stade de Belgrade.
Comment la France est-elle perçue aujourd’hui en Bosnie-Herzégovine, au regard de son action durant le conflit ?
Aujourd’hui, en Bosnie-Herzégovine, la France a plutôt une bonne presse compte tenu du rôle qu’a tenu l’Ambassade pour sortir les habitants de l’isolement dans lequel ils étaient. J’en veux pour exemple, il y a quelques années lors d’un retour à Sarajevo, je prends un taxi et le chauffeur me dit « ah Monsieur l’Ambassadeur, comment allez vous ?! ». Il m’avait reconnu et n’a pas voulu me faire payer la course !
Les Casques Bleus ont quand même fait un très bon travail sur le plan humanitaire à Sarajevo. Chaque fois qu’une ligne électrique sautait les Casques Bleus allaient la réparer, ce sont eux aussi qui apportaient de la farine dans les boulangeries, ou du fioul, tout le monde le savait et même si il y a eu quelques polémiques inutiles ils ont joué un rôle très positif à Sarajevo.
Le quotidien à Sarajevo pendant le siège, c’était quoi ?
Le quotidien c’était du camping, car il n’y avait pas d’Ambassade. Quand la Yougoslavie s’est effondrée il n’y avait qu’une Ambassade à Belgrade. Les premiers temps j’étais hébergé par le Général Morillon, puis j’ai installé l’Ambassade dans un 3 pièces qu’un Bataillon français m’avait prêté. J’ai logé à l’hôtel puis nous avons trouvé une ambassade mieux située que la précédente qui était sur l’allée des snipers.
Je me souviens de la visite d’Alain Juppé, Ministre des Affaires Etrangères, en février 94, après le massacre du marché de Markale, il a été surpris de voir une ambassade dans un F3, avec dans la pièce de gauche les lits de mes gardes du corps et dans celle de droite mon bureau ! C’était dangereux au quotidien, évidemment, mais j’avais une voiture blindée donc ça a été. C’était de l’improvisation permanente mais j’en garde un très bon souvenir.
Quel regard portez-vous sur la Bosnie-Herzégovine d’aujourd’hui, en quelques mots ?
Aujourd’hui je constate que c’est un pays qui n’a pas bougé, auquel on a donné des institutions qui sont tellement difficiles à faire fonctionner que ce pays régresse et n’a pas bougé depuis la guerre.
Lionel Duroy, entre Bosnie et Roumanie

La guerre de Bosnie-Herzégovine a inspiré de nombreux auteurs avec chacun sa vision du conflit, comme nous venons de le voir avec Bill Carter puis Henry Jacolin.
D’abord journaliste, Lionel Duroy s’est attaché à un sujet délicat dans son poignant roman « L’Hiver des hommes », paru en 2012 et plusieurs fois récompensé. Il s’intéresse au destin des enfants de criminels de guerre, à travers un fait historique avéré : le suicide de la fille du général Mladic en mars 94, surnommé le Boucher des Balkans, arrêté en 2011 et condamné fin 2017 à la prison à perpétuité pour génocide et crime contre l’humanité. Un suicide, avec l’arme de son père, remis en question par Mladic lui même, qui reste encore persuadé de l’assassinat de sa fille.
Lionel Duroy, via son personnage principal, mène une véritable enquête parfaitement écrite, basée sur des faits et des rencontres tout à fait réels. Ayant gardé quelques contacts après avoir couvert le conflit pour L’Evénement du jeudi, il est reparti à Pale, à l’est de Sarajevo, pour passer 6 mois dans cette ville historique des serbes de Bosnie, à la rencontre de nombreux témoins de l’époque, comme la femme du général Mladic et d’anciens criminels de guerre véritablement planqués. Certains pensant même que Mladic lui même y était caché au moment où Duroy écrivait son roman. Un livre incroyablement saisissant qui se lit comme un documentaire.

Dans son seizième roman “Eugenia“, sorti en avril 2019 et déjà auréolé du Prix Anaïs Nin, il nous emmène en Roumanie, à Iaşi plus précisément, au nord est du pays.
Il évoque avec précision la montée de l’antisémitisme en Roumanie, avec comme point de départ le tristement célèbre pogrom de Iaşi en 1941, où périrent en quelques jours 13 000 juifs sur un total de 50 000, dans une ville où les juifs représentaient la moitié de la population.
Lionel Duroy est un écrivain passionné et méticuleux, il s’est installé à Iaşi durant l’écriture de son roman afin de disposer de toutes les ressources nécessaires pour relater des faits historiques précis et des personnages ayant réellement existé. Là encore il cherche à comprendre comment des hommes, de simples voisins ou commerçants, peuvent devenir des bourreaux.
“À la fin des années trente, parce qu’elle est tombée sous le charme d’un romancier d’origine juive, Eugenia, une jeune et brillante étudiante roumaine, prend soudain conscience de la vague de haine antisémite qui se répand dans son pays. Peu à peu, la société entière semble frappée par cette gangrène morale, y compris certains membres de sa propre famille. Comment résister, lutter, témoigner, quand tout le monde autour de soi semble hypnotisé par la tentation de la barbarie ?
Avec pour toile de fond l’ascension du fascisme européen, il dresse le portrait d’une femme libre, animée par le besoin insatiable de comprendre l’origine du mal. Ce livre est aussi une mise en garde contre le retour des heures les plus sombres de l’Histoire”.

Jasna Samic, Prix du Salon 2018 
Table ronde avec Jasna Samic, Luan Starova et Ömer Kaleşi, animée par Nicolas Trifon
Des gris-gris en Albanie
Passons à un sujet plus léger, avec la photographe Catherine Vinay qui nous fait découvrir une coutume, si l’on peut l’appeler ainsi, typiquement albanaise, qu’elle a choisi de relater dans un recueil de photographies récemment sorti : « Gris Gris d’Albanie ».

“J’ai découvert en Albanie un phénomène assez spécifique, qui est le fait que les albanais placent devant leur balcon, leur terrasse ou dans les étages des maisons en cours de construction, des jouets, des peluches, des poupées ou des petites sorcières. Ces charmantes créatures sont destinées à éloigner le mauvais œil.
La première fois que je suis allé en Albanie il y a 5 ans j’avais vu quelques peluches sans les identifier, puis lors d’un second voyage j’en ai retrouvé dans une autre partie de l’Albanie, en plus grand nombre, je me suis alors décidée à en faire un vrai sujet de travail. Je dois avoir aujourd’hui un corpus d’environ 200 peluches différentes.
Ce phénomène n’a pas de nom particulier, on trouve des « dodolec » mais qui sont des épouvantails, réservés aux jardins. Lorsque je me ballade avec mon appareil photo et que l’on me demande ce que je fais, j’utilise le mot italien de « peluchi », que tout le monde comprend”.
Étonnant, non ?!
L’Europe de Kapllani
Restons en Albanie, côté roman cette fois. Armand de Saint Sauveur, fondateur des éditions Intervalles, tient à présent à nous présenter un autre auteur traduit et édité par sa maison d’édition, Gazmend Kapllani, un auteur albanais d’expression grecque.
Dans son premier livre « Petit journal de bord des frontières », il évoque avec ironie l’Albanie d’Enver Hoxha, “un pays tellement fermé que le monde extérieur devient quasiment de l’ordre du fantasme pour ses habitants”. Lorsque les murs d’un tel pays tombent c’est le début d’une nouvelle vie pour des habitants qui veulent s’en aller vers ce monde totalement fantasmé qu’ils voient comme un eldorado mais qui se terminera dans l’équivalent grec de Sangate.

Dans son second livre, « Je m’appelle Europe », il raconte la suite, le sort d’un albanais qui arrive en Grèce, un pays dans lequel il n’est pas le bienvenu mais où il va construire une nouvelle identité. C’est un texte très fort, « l’un des textes les plus forts que j’ai pu lire et publier , sur cette chose très particulière qui est le changement de langue. C’est peut être l’équivalent d’un Kundera albanais, un exemple assez unique du passage d’une culture à une autre dans un pays où les étapes ont été très douloureuses et en même temps très jubilatoires à franchir puisque c’est un auteur qui a beaucoup d’humour », nous dit-il.
Son troisième livre, « La dernière page », fait un peu le chemin inverse, à partir d’un fait historique sur lequel Kapllani a fait beaucoup de recherches : l’histoire de ces juifs de Salonique qui ont fuit les Nazis en se cachant en Albanie, “qui était probablement le seul pays d’Europe à avoir plus de juifs à la fin de la guerre qu’au début”. Ces juifs se retrouvent alors en Albanie et changent d’identité, de religion pour devenir musulmans, communistes, et sont ensuite broyés par le régime d’Enver Hoxha. “Ce mouvement à la fois culturel, géographique et psychologique, explique très bien la complexité des identités dans les Balkans d’aujourd’hui”.
Son quatrième roman est en cours de traduction et sortira en septembre prochain. L’histoire se déroule dans une ville albanaise imaginaire qui concentre tous les maux de l’Europe chaotique d’aujourd’hui. C’est une réflexion sur le nationalisme, le cosmopolitisme et les frontières, comme quasiment toute son œuvre, à travers l’histoire de deux frères aux histoires différentes confrontés aux mêmes événements.
Dé-sol-ation

Cette thématique de l’exode, du changement d’identité, de culture, est un sujet on ne peut plus actuel. La journaliste Marie Christine Navarro vient d’en faire un livre, « DE-SOL-ATION », paru en avril 2019 chez Petra.
Passionnée par la Grèce depuis une vingtaine d’années, elle a décidé, un jour de 2016, de donner la parole à ces réfugiés pour raconter leur histoire. Touchée par cette vision de ces hommes, femmes et enfants en déshérence dans les rues, elle ne pouvait plus se contenter d’être une simple vacancière dans un pays qu’elle aime tant et où elle se rend chaque année, elle se devait d’agir à sa façon pour témoigner du drame humain qui se jouait sous ses yeux.
“Il s’agit d’un livre sur l’arrachement, à la fois au sol et à sa patrie, un carnet de voyage effectué en Grèce en 2016 2017 auprès des réfugiés à Athènes et à Lesbos ainsi qu’auprès des personnes et associations qui s’occupent de ces réfugiés”.
Elle a ainsi suivi de nombreux réfugiés et a pu observer comment leur situation avait évolué, à la fois pour ceux qui étaient complètement coincés dans les camps, ceux qui sortaient d’une manière clandestine, ou ceux qui décidaient de retourner dans leurs pays. “Ce livre est un kaléidoscope de voix qui se croisent, la mienne car c’est mon carnet de route jour après jour, mais c’est aussi la voix de ces réfugiés”.
Bien qu’elle reconnaît avoir interviewé des personnalités politiques qui ont fait preuve d’une extraordinaire lucidité sur la situation, elle précise que cela n’est en rien un problème grec, c’est un véritable problème européen. “Pour moi il y a un grand responsable, c’est François Hollande, il a raté le coche historique avec Angela Merkel. A partir de là s’est déclenché tout un processus qui a été supporté par la Grèce, qui subissait déjà une crise épouvantable, mais aussi par l’Italie qui était fragilisée”.
Un lieu apparaît comme un symbole dans son récit, le Café Damas, situé à Mytilène, ville principale de l’Île de Lesbos. Ce lieu avait été créé par un patron grec parlant l’arabe, qui avait parfaitement compris qu’il ne fallait pas séparer la population locale de la population réfugiée.
“J’y suis souvent allée et c’est là que beaucoup de réfugiés m’ont raconté leur histoire”, nous confie Marie Christine Navarro. Elle poursuit : « C’était un symbole de solidarité, car voir inscrit à l’entrée Café restaurant halal, avec le drapeau grec et la croix orthodoxe, c’est extraordinaire ».
Et à mesure que la crise des réfugiés s’est amplifiée, qui d’ailleurs, précise t elle, est plutôt “la crise de l’accueil des réfugiés”, des pressions ont été exercées sur le patron par le mouvement d’extrême droite Aube Dorée, qui a eu pour conséquence la transformation de ce lieu symbolique en grill house dans lequel on sert désormais essentiellement de la viande de porc. Les autorités locales ainsi que l’état ont laissé pourrir la situation, et lorsque l’on laisse la situation s’envenimer, les violences arrivent.
Marie Christine Navarro a croisé les destins de nombreuses personnes de tous horizons, mais certains sont particulièrement marquant et symbolisent parfaitement la situation de ces réfugiés et du trafic humain qu’il y a derrière.
Elle nous parle de sa rencontre avec cette afghane, musulmane mais non voilée, venue avec sa mère au prix de 17 000€. “Beaucoup de réfugiés font partie de la classe moyenne haute, comme cette afghane, mais beaucoup d’autres ont été contraints de vendre leur maison et ne possèdent plus rien, tout ce qui leur restait ayant été mis dans ce voyage”.
“J’ai aussi interviewé une famille syrienne avec une femme psychologue et une fille ingénieure, qui, lors de sa traversée entre la Turquie et la Grèce, a du mettre ses enfants sur cette barque sans gilets de sauvetage. Elle dit avoir dû prendre la décision la plus grande de sa vie”.
Lorsque l’on lui demande si c’est un livre fataliste, elle nous répond que c’est au contraire un livre humaniste mais tragique, qui relate la tragédie de notre temps, qui dépasse la Grèce et même l’Europe.
Son constat est simple et alarmiste lorsque l’on évoque l’avenir de cette crise : “les signaux sont actuellement tous au rouge, car les grandes démocraties mondiales sont très faibles avec Trump d’un côté, Poutine de l’autre, et la Chine au milieu. Sans oublier la guerre dans les pays du Moyen Orient et en Afrique. On arrive à vouloir ériger des murs…et quand on érige des murs ce n’est jamais bon signe, l’Histoire nous l’enseigne”, conclut elle.

Ömer Kaleşi 
Luan Starova, écrivain et ancien ambassadeur
And the winner is…

En fin de journée, le moment tant attendu arrive, l’annonce du Prix du Salon, décerné par le jury des étudiants de l’Inalco. C’est Jean Louis Bachelet qui est lauréat cette année, avec son roman “Noces Tchétchènes – Vie et Mort d’une Kamikaze“, paru aux éditions Slovènes & Cie en novembre 2018.
En fin de journée, le moment tant attendu arrive, l’annonce du Prix du Salon, décerné par le jury des étudiants de l’Inalco. C’est Jean Louis Bachelet qui est lauréat cette année, avec son roman “Noces Tchétchènes – Vie et Mort d’une Kamikaze“, paru aux éditions Slovènes & Cie en novembre 2018.
Pour son éditrice Zdenka Stimac : “c’est un livre vraiment d’actualité, puisque l’on y retrouve les mêmes problématiques qu’en France mais simplement déplacées dans le Caucase”. L’écriture de Jean Louis Bachelet arrive à plonger le lecteur dans la beauté de ce Caucase, de ses traditions ancestrales et de sa musique.
“Le Caucase c’est le pays de tous les contrastes”, nous explique Jean Louis Bachelet, “on y trouve la splendeur des paysages, la luxuriance des costumes, le côté très festif des traditions, et en même temps des comportements extrêmes qui sont liés en partie à l’Histoire (le peuple tchétchène a déporté en masse par les russes en 1944, puis les guerres de Tchétchénie), qui a pour conséquence un très fort potentiel de rancune là bas et engendre un certain nombre de comportements de radicalisation. Ils sont pour moi la cristallisation de tout ce qu’on peut vivre ici mais exacerbé par le contexte de la Russie actuelle”.
Pour ce roman, Jean Louis Bachelet a suivit le parcours tout à fait réel de plusieurs jeunes filles radicalisées afin d’en dresser un personnage type qui incarne le prototype de la kamikaze, afin d’explorer “le cheminement qu’elle a pu suivre pour en arriver la, en étant partie d’une vie tout à fait normale”.

Nous remercions chaleureusement Sophie Lecomte, Jean Louis Bachelet, Zdenka Stimac, Henry Jacolin, Catherine Vinay, Guillaume de Saint Sauveur, Lionel Duroy et Marie Christine Navarro, pour le temps qu’ils nous ont consacré, ainsi qu’Yves Rousselet, Pascal Hamon, Evelyne Noygues et toute l’équipe du Salon du Livre des Balkans pour sa confiance et l’opportunité de ce partenariat que nous espérons renouveler l’an prochain !
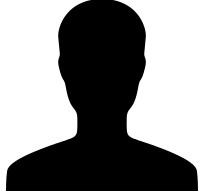




Vous devez être connecté pour poster un commentaire.