Zakhar Prilepine – Roman en fragments, chaque chapitre pouvant être une nouvelle indépendante. On y suit les souvenirs, la mémoire disloquée d’un trentenaire en prise avec la Russie. Amoureux, adolescent, fossoyeur, compagnon de beuverie, militaire, Zakhar porte un regard tendre et brutal sur ce qu’on peut nommer la vie.
« – Donne moi ta bague.
– Je ne peux pas. Elle est…à moi. »
Le débat subtil de l’homme ou de l’œuvre

“Le Péché” est un roman contemporain, et son auteur Zakhar Prilepine -ou Prilepin- est par conséquent un de nos contemporains. Si ses romans font l’unanimité en librairie et remportent de nombreux prix (“Le Péché” inclus, lauréat du prix Super Nabtsest en Russie), l’homme, lui, déclenche la controverse.
Militaire de formation, il a participé à la guerre de Tchétchénie dans les années 90 et fût un des disciples actifs de Limonov, le leader politique du parti d’opposition « L’autre Russie ». Mais ce qui fait le plus débat autour de Prilepine, c’est son engagement récent dans les forces militaires de la République de Donetsk. Pour vulgariser, il est à la tête d’un bataillon pro-russe dans la guerre qui déchire actuellement l’Ukraine.
Dans un contexte géopolitique tendu avec la Russie, Emmanuel Macron ayant boycotté le stand russe du salon du Livre 2018 où était invité Prilepine. Ce geste de notre président censé être dirigé contre la Russie en tant qu’entité politique se dirige in fine contre la littérature pour l’écrivain. C’est une réflexion intéressante qui amène la suivante : puis-je vous parler du Péché en excluant l’angle des engagements politiques de Prilepine ?
Concrètement, “Le Péché” ayant été publié en 2007, je pourrais détacher ma chronique des engagements actuels de Prilepine. Mais quand j’analyse des auteurs décédés, il m’arrive d’inscrire leurs romans dans un contexte de vie plus général et parfois postérieur à leurs publications.
Ainsi il ne s’agit pas de distinguer l’homme de l’œuvre sur un critère chronologique ou philosophique. Mais il ne s’agit pas non plus de les lier inextricablement. Il existe un gradient souple entre des auteurs engagés et des œuvres engagées. L’un ne signifie pas nécessairement l’autre. Et c’est dans ce gradient que je souhaite analyser “Le Péché”.
Point de chronique géopolitique ici. Elle serait bien bancale et je laisse cette expertise à certains de mes collègues d’Hajde. Je ne juge pas l’engagement d’un auteur. Je lis autant Desnos le résistant français que Hamsun le nationaliste allemand. Ce qui nous intéresse ici dans la littérature de l’Est c’est sa capacité à aiguiser la critique de la pensée humaine.
Et ce qui est politique dans la littérature c’est l’exploration d’un homme qui s’inscrit dans une société donnée et de cette société qui vient marquer l’homme. C’est la politique dans son sens étymologique. La lecture du Péché nous intéressera donc dans son potentiel littéraire et non partisan : ce qui est exploré de la pensée de l’homme et du lien qui le noue à son pays.
Péché de commettre ou péché d’être
“Le Péché” est un roman fragmenté. Il s’ouvre sur une parenthèse amoureuse idyllique et se ferme sur la guerre. La mémoire étant soluble, les fragments n’ont pas de cohérence linéaire. Enfance à la campagne, premiers émois sensuels, errance de l’âge adulte, angoisse parentale… Tout cela s’entremêle. Et dans chaque fragment se dessine une perspective sur l’amour, le lien affectif, la mort. La violence également. Une recherche de sens tout aussi disloquée que le narrateur -qui se nomme Zakhar- et que les nuits de Moscou.
Le titre équivoque du roman nous amène à nous demander quel est le Péché et où se situe-t-il. On peut penser évidemment aux sept péchés capitaux ou plus généralement à la transgression de la morale. Or, spoil philosophique, de péché vous ne trouverez point dans ce roman. Oui Zakhar transgresse parfois. Il est violent, souvent. Dès gamin, dans des bagarres de genoux et de coudes pour défendre son frère. Quand il perd son chien et se met en tête qu’un sans abri l’a volé pour le manger.
Quand il est videur de boîte de nuit et hume les règlements de compte dans l’alcool suant, tel un animal, jusqu’à passer un client à tabac. Mais ce n’est pas un roman didactique et la violence y est assumée plus que transgressive. Elle est normalisée, elle est propre aux nuits de Moscou et aux enfants qui courent dans la campagne. Elle décrit une psychologie virilisée, elle est un exutoire psychique et une décompensation musculaire. Elle y est le reflet d’une vie en tension.
S’il n’y a pas de péché à proprement parler dans ce roman, il achoppe la pensée du narrateur à chaque chapitre. Ainsi tout souvenir comporte la potentialité d’un péché. La mémoire le creuse, l’évoque ou le rejette. Zakhar le narrateur, tout comme Zakhar l’auteur, écrit honteusement des poèmes qu’il cache sous son lit car il est fils de paysan. Péché de classe peut-être ? Zakhar culpabilise de laisser son grand-père seul pour courir les filles. Zakhar blasphème dans une scène dérangeante d’humour impliquant vodka, fossoyeurs et photographies. Les autres aussi explorent des potentialités de péchés.
Ces voisins qu’il entend se harceler à travers les murs en papier de son appartement. Ces militaires qui manipulent les filles. Cet homme dans l’ascenseur avec qui Zakhar se dispute en essayant de faire rentrer la poussette de son neveu. Quelques lignes plus tard, l’homme de l’ascenseur est penché sur la rambarde et il y a un crachat sur le bambin.
Prilepine a une plume sublime qui pose des scènes visuelles qui vous resteront à l’esprit, spectateur impuissant d’un film étrange. Et par cette plume, il explore comment le vécu d’un homme laisse une empreinte quasiment charnel dans son coeur. Cela culmine dans le chapitre « Le carré blanc ». Ici la mémoire floue de Zakhar sur un souvenir de petite enfance, associé au jugement fragile de l’enfant, vient confronter notre regard horrifié d’adulte dans une partie de cache-cache que je ne souhaite pas vous dévoiler.
La morale à l’aune d’une vie
Tous ces chapitres effleurent la notion de péché et de transgression pour y poser l’éventualité de son pendant : la morale. Et le roman ne prend tout son sens que par le chapitre final. Zakhar y est militaire, capitaine d’un bataillon minable, qui s’emmerde à crever dans son arrière-base et où personne ne fait preuve d’empathie envers les autres. Et puis l’ennemi arrive et une autre lecture du roman s’ouvre.
La fragmentation littéraire est alors pertinente à relever : « le carré blanc » et les souvenirs de petite enfance, premiers souvenirs où l’on entrevoit la mère de Zakhar.
Puis suit un long poème en prose « En d’autres termes ». L’insertion étrange de ce poème semble être un condensé de tout le roman. Zakhar y évoque avoir vécu plus d’une fois et ne plus avoir la force de vivre encore (tant de vies effleurées dans les chapitres en fragments). Il y parle d’amour et de nuits, de son père, d’oiseaux et de livres. Il mêle dans la même image le souvenir d’un enfant qui court après les poussins à la ferme et des gardiens de musée qui ne se souviennent pas de Staline.
Et tous ces fragments semblent soudain attachés à ce qui court durant tout le roman : les souvenirs d’une vie s’ancrent dans un territoire, ce territoire est la Russie et Zakhar glisse subrepticement sur une poésie libre et moderne qui parle de « la mère Patrie ! nous sommes ton troupeau. Bâfre toi chienne ! Nous le payons de notre sang. » .
Tous ces fragments sont mineurs. Il ne se passe rien de grandiose. Et l’évènement militaire lui-même semble mineur et ne s’embarrasse pas d’explication politique. Mais ces fragments sont la vie. Celle de Zakhar, celles des autres. Et cette vie est attachée à la Russie, personnage de fond du livre. Cela ne devient signifiant qu’à ce dernier chapitre, où la mère sera de nouveau évoquée sensiblement ainsi que les enfants de Zakhar. Et le sens du roman se dévoile alors. Une errance absurde de l’homme dans la vie sans y apposer nécessairement de sens, jusque qu’à ce que son pays force sa marche.
Dans le premier chapitre Zakhar évoque les inimitiés du monde artistique de Moscou, pré et post communiste. Le livre est lourd des pièces de zinc de la monnaie russe, mordant de ses hivers, assoupie de ses étés, tout le monde y est militaire, Moscou est haïe et désirée, la campagne à des odeurs qui n’existent nulle part ailleurs, Zakhar écrit des poèmes sur la Russie. Ce n’est pas une ode à la Russie, ne nous détrompons pas. Mais la Russie est là et l’homme qui y vit y est forcément russe, comme Zakhar et ses amis aiment à le dire et à s’en plaindre, entre bortsch et vodka.
La Russie s’est imprimée en Zakhar. C’est une danse entre son pays et ses souvenirs et “Le Péché”, peut-être est-ce la terre… Car voici que dans ce dernier chapitre, pastiche de tout ce qu’il y a de ridicule dans la guerre et dans ce bataillon de bras cassés qui ne veulent pas la faire, et qui cherchent juste à attraper un camion pour rentrer à la maison sous les tirs ennemis, les souvenirs de tout le roman assaillent le militaire, que le liant de tous ces souvenirs est la Russie et que ce militaire dépassé, flanqué dans la boue, nous dévoile cette pensée « pourquoi je rampe sur le sol de mon pays ? ».
Le péché et la morale dessinent alors leur silhouette à l’orée de la guerre. Il n’y a pas de guerre juste et ainsi il n’y a pas de morale. La vie s’interprète selon son propre mouvement, et ce mouvement s’inscrit puissamment dans un territoire. Ce que cela implique est propre à chacun. Peut-être que tout est Péché.
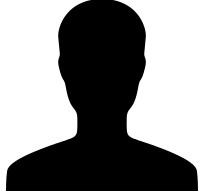


Vous devez être connecté pour poster un commentaire.